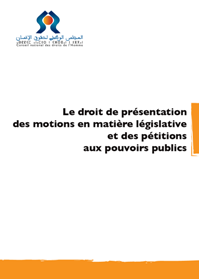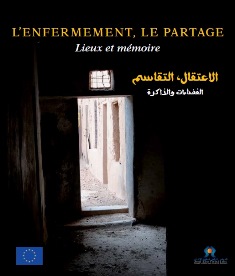Marocains si vous saviez...
Celui qui a présidé l’Instance Équité et Réconciliation (IER), chargée de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l’homme dans le royaume chérifien depuis l’indépendance, dit tout sur les circonstances de la création de cette « commission vérité », sur son fonctionnement, ses moyens, ses résultats ?et... ses limites. Il évoque aussi pour la première fois son propre parcours.Celui qui a présidé l’Instance Équité et Réconciliation (IER), chargée de faire la lumière sur les atteintes aux droits de l’homme dans le royaume chérifien depuis l’indépendance, dit tout sur les circonstances de la création de cette « commission vérité », sur son fonctionnement, ses moyens, ses résultats ?et... ses limites. Il évoque aussi pour la première fois son propre parcours.
La sérénité. C’est le trait dominant de la personnalité de Driss Benzekri, le président de l’Instance Équité et Réconciliation (IER), et rien ne semble pouvoir entamer cette égalité d’âme. Fruit sans doute de l’adversité assumée et d’une longue méditation forcée (dix-sept ans de prison), elle donne à l’ancien militant maoïste converti dans la défense des droits de l’homme une force de conviction communicative. L’« ère nouvelle » a suscité une formidable liberté d’expression qui s’accompagne de la libération des instincts les plus vils, et le président de l’IER a eu sa part de médisances et de calomnies.
Mais jamais l’intéressé ne manifeste le moindre sentiment d’agacement ou d’impatience.
Depuis la fin de la mission de l’IER, le 30 novembre 2005, il a multiplié interviews et conférences. Il répond volontiers aux questions, y compris les plus farfelues - avec cette équanimité à toute épreuve. Voix douce à peine audible, éternel sourire de sage asiatique, il prend le temps d’expliquer, rappelant patiemment les faits et leur contexte, établissant des parallèles approfondis avec les expériences des autres pays en matière de « commission vérité » pour mieux éclairer la démarche marocaine. La sincérité évidente, l’honnêteté intellectuelle sans faille se conjuguent avec ce parti pris résolument didactique et finissent par désarmer les réactions que suscite encore l’IER, faites souvent d’interrogations et de préventions, de scepticisme et d’hostilité.
Mais il ne faut pas se tromper : la sérénité n’exclut pas l’efficacité. Driss Benzekri n’est pas seulement un honnête homme, c’est un homme d’action. La mission de l’IER n’était pas évidente et exigeait des qualités politiques et diplomatiques ainsi que des capacités exceptionnelles de planification et d’organisation. Il fallait au départ rassembler des hommes et des femmes ayant souvent souffert de la répression mais qui venaient d’horizons différents, et faire travailler ensemble des personnalités affirmées pas toujours commodes. Pour diligenter les enquêtes sur les graves violations des droits de l’homme depuis l’indépendance jusqu’à la fin du règne de Hassan II (de 1956 à 1999), il était nécessaire de s’armer de discrétion et d’obtenir le concours des appareils et institutions étatiques (administration, armée, police, services…), qui n’était nullement acquis. Tout en sauvegardant l’indépendance vitale de l’IER, il convenait, dans les indispensables relations avec le Palais royal, de trouver la bonne distance. Enfin, il ne faut pas oublier que tout au long de l’entreprise, et en particulier lors des audiences publiques des victimes, les risques de dérapage étaient bien réels, tout autant que les provocations. On le voit, l’IER n’était pas une mince affaire et il fallait un homme d’exception pour la mener à bien.
Si, au cours de l’interview, Driss Benzekri parlait facilement de l’IER, des conditions (peu connues) de sa naissance, du fonctionnement et du travail accompli, il était difficile de le faire parler de lui-même et de son itinéraire. Abnégation du militant, séquelles du marxisme qui considère l’individu comme une tare petite-bourgeoise, pudeur berbère… On avait scrupule à lui poser des questions personnelles qui devenaient des agressions caractérisées. Il commençait par leur opposer un long sourire silencieux qui signifiait « est-ce vraiment intéressant ? » avant de lâcher des bribes d’information. C’est dire que le retour sur son parcours qu’on va lire dans la deuxième partie de l’interview est une première. À tous égards : ni lui-même ni les autres acteurs de la mouvance gauchiste des années 1970 n’avaient jamais jeté un regard critique sur leur expérience.
J.A./L’INTELLIGENT : Comment est née l’idée d’une commission vérité au Maroc ? DRISS BENZEKRI : C’est en novembre 1999 qu’a été créé, à l’initiative d’une ONG rassemblant d’anciens prisonniers politiques, le Forum Vérité et Justice (FVJ), dont j’ai été président. Le contexte était des plus favorables : gouvernement d’alternance et succession monarchique réussie. Notre objectif était de sortir du carcan traditionnel, revendicatif et dénonciateur, et de proposer, dans le contexte d’une démocratie en transition, des solutions concrètes en matière de politique des droits de l’homme. Deux autres facteurs ont été déterminants : la volonté du nouveau souverain lui-même et de ses proches collaborateurs, d’une part, et l’attitude des dirigeants du Forum à l’époque, d’autre part. Après avoir vaincu les réticences de certaines associations actives dans le domaine des droits de l’homme et d’une partie de la classe politique, le Forum a réussi à fédérer une large coalition autour de cette idée. Moins d’un an après, des proches collaborateurs du roi ont pris l’initiative d’ouvrir le dialogue avec le FVJ sur la pertinence et l’opportunité de notre programme, ainsi que sur les implications sociales et politiques de sa mise en œuvre… Mais pour bien comprendre l’émergence d’une commission vérité au Maroc, il faut revenir au contexte de l’époque. De 1990 à 1998, un millier de détenus sont libérés, des lois répressives sont abolies et de nouvelles réformes intègrent les normes internationales dans la législation marocaine, tandis qu’on s’achemine vers une démocratisation « consensuelle ». En octobre 1998, Hassan II évoque devant le Parlement les abus du passé avant de charger le CCDH (Conseil consultatif des droits de l’homme) d’examiner la question et de présenter des résolutions adéquates. La réponse du CCDH ne fait pas l’unanimité. L’OMDH (Organisation marocaine des droits de l’homme) a développé une analyse lucide des moyens et des méthodes du CCDH et a tracé des pistes pour une solution équitable en matière de recherche de la vérité et de lutte contre l’impunité. J’en étais alors vice-président, et je représentais, avec des col¬lègues, cette organisation dans une coordination de groupes informels de familles des victimes. Dans ce cadre aussi, nous avons élaboré les premières évaluations critiques sur la question de la vérité, sur les disparus, sur l’indemnisation des victimes et sur l’« amnistie réciproque ». S’agissant de l’établissement des faits et de l’élucidation de 112 cas de « disparitions forcées », chiffre présenté à cette époque par le CCDH, il est vite apparu qu’aucune investigation sérieuse n’avait été menée, et la question des mécanismes et des procédures de la recherche de la vérité est devenue prioritaire. La commission d’indemnisation, autre proposition du CCDH, était une bonne décision dans la mesure où elle impliquait la responsabilité de l’État et permettait de satisfaire le droit à réparations des victimes, mais elle s’apparentait à une tentative d’acheter le silence des victimes aussi longtemps qu’on faisait l’impasse sur la vérité. Le débat sur l’amnistie avait donné lieu à des controverses pas toujours sereines ni réfléchies. Finalement, et tout en reconnaissant que des mesures politiques de ce type, dictées par des choix démocratiques, étaient concevables et légitimes, nous avons estimé qu’il était moralement inadmissible de les imposer aux victimes sans un véritable processus d’établissement de la vérité et de détermination des responsabilités. Si la réconciliation était souhaitable, elle ne se décrétait pas. Les anciens détenus regroupés dans le Forum Vérité et Justice étaient-ils de tous les bords ? Le Forum comprenait, entre autres, des familles de disparus, des anciens d’Ilal Amam, du 23-Mars, de l’UNFP [Union nationale des forces populaires], de l’Avant-Garde, des Sahraouis dont des partisans du Polisario, d’anciens résistants, des anciens de Tazmamart, des islamistes… C’est dans ce cadre que j’ai été appelé à animer, avec des camarades, dont Salah el-Ouadie, le comité préparatoire du Congrès constitutif. J’ai rédigé un document qui proposait une lecture de la situation politique et des droits de l’homme, de la nature de la transition démocratique et du gouvernement d’alternance dirigé par Abderrahmane Youssoufi. Il s’interrogeait sur les chances de réussite d’une démocratie qu’on tentait de construire sur un legs non apuré en matière de droits de l’homme, et préconisait la création d’une commission vérité. Tout au long de votre démarche, vous semblez privilégier un légalisme à tous crins. Pourquoi ? Permettez-moi de vous rappeler ce qu’est une commission vérité. Il s’agit d’un organisme public non juridictionnel d’investigation créé pour une durée limitée, chargé d’établir les faits et de déterminer les respon¬sabilités sur la violation systématique des droits de l’homme pendant une période historique donnée. Il contribue à aider la société à affronter son passé de manière critique et sereine, et il formule, dans un rapport final, des recommandations générales ou spécifiques sur les programmes de répara¬tions et de réhabilitation des victimes et sur les réformes constitutionnelles, juridiques, institutionnelles et éducatives nécessaires pour garantir la non-répétition des violations. À ne pas confondre, donc, avec les commissions d’enquête parlementaires ou extraparlementaires. En quoi consistaient les activités du Forum ? Nous avons entrepris, dans un premier temps, de sensibiliser la société. Nous craignions d’être perçus comme d’anciennes victimes agitant des problèmes du passé au détriment du présent et de l’avenir, au mépris des questions d’ordre économique ou politique qui préoccupaient à juste titre nos concitoyens. Il fallait donc gagner l’adhésion de la population, en expliquant notre démarche. En 2001 et 2002, nous avons mené des campagnes de sensibilisation de l’opinion, nous organisions des sit-in, des veillées près des anciens lieux de détention de manière à rallier tous ceux qui éprouvaient de la sympathie pour notre action, mais redoutaient les manifestations sectaires pouvant tourner mal. Nous organisions aussi des conférences, des témoignages d’anciennes victimes. C’est ainsi que des tabous étaient brisés, la parole libérée, et que les « victimes », reconnues comme des personnes, prenaient des visages et que leur voix était écoutée. Elles n’étaient plus des abstractions ou des chiffres. Toute la gauche nous a finalement soutenus, l’Istiqlal également. Certains groupes fondamentalistes adhéraient à notre démarche, mais du bout des lèvres, et cherchaient surtout à instrumentaliser les capacités de mobilisation de la nouvelle organisation. C’est alors que vous vous êtes approchés du Palais ? Un jour, on m’appelle pour rencontrer de nouveaux responsables du gouvernement et des personnalités proches de Sa Majesté, qui voulait comprendre l’approche préconisée par la nouvelle association des victimes. De nombreuses réunions ont alors été organisées, auxquelles participèrent, entre autres, Fouad Ali el-Himma, actuel ministre délégué à l’Intérieur, et des membres du bureau exécutif du Forum Vérité et Justice, dont Khadija Rouissi, Salah el-Ouadie, Abdelkrim Manouzi et moi-même. Le dialogue était franc et serein. Nous expliquions notre démarche et notre proposition de mettre en place une commission vérité. Concernant la justice pénale, et même si nos propositions ne fixaient pas de position tranchée, nous soutenions qu’il convenait d’établir les responsabilités des abus commis dans la gestion des conflits ou des contestations sociales survenus au cours des quarante années passées, d’envisager des sanctions, mais pas seulement de type judiciaire. Nous avons été très agréablement surpris par l’écoute que nous avons rencontrée de la part de responsables disposés à discuter, qui cherchaient à comprendre, qui posaient des questions de fond et s’interrogeaient sur les différentes modalités d’établissement des responsabilités. En résumé, il est apparu que le souverain était totalement engagé dans la modernisation et la démocratisation du pays, mais aussi dans le renouvellement des élites et du personnel dirigeant avec le souci de préserver la stabilité et la cohésion sociales nécessaires à tout développement démocratique. Qu’en était-il, au cours de ces entretiens, de la question si controversée du jugement des coupables ? Je pensais qu’il était nécessaire d’organiser des enquêtes, y compris judiciaires, pour l’établissement de la vérité, mais pas nécessairement dans le but d’engager des poursuites au pénal ou de sanctionner. Il fallait trouver les moyens et mécanismes adaptés pour établir clairement les responsabilités institutionnelles ainsi que les responsabilités individuelles dans les abus les plus flagrants. Car nos interlocuteurs insistaient, à juste titre, sur la nécessité de faire justice sans entraîner la société dans des situations de division et de chasse aux sorcières ou de règlements de comptes. Ce qui traduisait l’opinion générale, à l’époque, de la société et de l’ensemble de la classe politique. L’IER a achevé ses travaux le 30 novembre 2005. Quelles sont les grandes lignes de son rapport final ? Après trente mois d’investigations et de débats publics, le mandat de l’IER a pris fin à cette date par la remise au roi de ce rapport. Celui-ci dresse, en six volumes, les résultats des enquêtes que nous avons menées sur les graves violations des droits de l’homme perpétrées entre 1956 et 1999, ainsi que sur les responsabilités des appareils étatiques ou autres ; il évoque les mesures destinées à réparer les préjudices subis par les victimes ; il présente enfin des recommandations de réformes législatives, institutionnelles, politiques et éducatives. Le rapport est disponible sur le site Internet de l’IER (www.ier.ma), qui continuera à fournir d’autres informations sur le travail accompli. Sa gestion sera probablement assurée par le Conseil consultatif des droits de l’homme. Quels sont les principaux résultats ? En ce qui concerne « l’établissement de la vérité et la détermination des responsabilités », nos investigations ont permis d’élucider le sort de 742 personnes portées disparues et de recommander la poursuite des investigations dans 66 autres cas qui réunissent les éléments constitutifs de la « disparition forcée ». Dans la plupart des cas, l’IER a établi la responsabilité des différents services de sécurité. Les victimes des violations et leurs ayants droit ont été reconnus en tant que tels et écoutés par l’ensemble de la société marocaine ; près de 10 000 seront indemnisés (en plus des 5 000 déjà indemnisés par l’ancienne commission d’arbitrage entre 1999 et 2003) et bénéficieront de la couverture médicale obligatoire. Près de 50 victimes souffrant de séquelles graves et chroniques bénéficie¬ront d’une prise en charge immédiate et personnalisée, mesure qui s’ajoute aux soins d’urgence prodigués à un millier de victimes pendant les travaux de l’IER, avec le concours du ministère de la Santé. L’IER recommande, en outre, la création d’un dispositif permanent d’orientation et d’assistance médicale des victimes de la violence et de la maltraitance. En matière de « réparation communautaire », l’IER préconise de nombreux programmes de développement socio-économique et culturel en faveur de plusieurs régions et groupes de victimes, notamment les femmes. S’agissant des garanties de prévention, l’IER a préconisé des réformes constitutionnelles destinées à la consolidation des libertés et des droits fondamentaux, à la mise en œuvre d’une stratégie nationale de lutte contre l’impunité et au suivi des recommandations, afin de renforcer les moyens et les capacités de prévention des violations, ainsi que le processus de transition démocratique dans lequel le pays s’est engagé. Comment le travail de l’IER a-t-il été organisé ? Les statuts de l’IER, élaborés par les membres de l’Instance eux-mêmes, avant de faire l’objet d’un décret royal, ont défini les normes et procédures de la conduite de ses missions, son fonctionnement et son organisation. Ses 17 membres ont supervisé, lors de réunions régulières, l’ensemble du travail, et conduit, à travers des groupes de travail et des comités spécialisés, les programmes des investigations, des réparations, des communications, des audiences publiques, ainsi que du processus d’élaboration et de rédaction du rapport final. Pour mener à bien ce travail immense, l’IER s’est dotée d’une administration constituée de cadres administratifs, enquêteurs, chercheurs, secrétaires, ingénieurs, informaticiens, archivistes, documen¬talistes, constitutionnalistes, spécialistes des questions de sécurité… j’en passe. Quels étaient les effectifs ? Dans les moments de pointe, jusqu’à 350, dont plus de la moitié de femmes. Pour que cette équipe soit non seulement compétente, mais aussi représentative, nous avons recruté dans toutes les universités du Maroc. Bref, il y a eu environ 150 permanents, entourés d’un nombre variable d’experts affectés à des travaux ponctuels. À cela s’est ajoutée une équipe que nous n’avions pas prévue au départ, qui devait assurer le suivi médical et sanitaire de personnes qu’il fallait prendre en charge. Un millier de personnes ont ainsi été traitées dans les différentes régions. Comment avez-vous mené les investigations ? Tout a commencé par des recherches dans les archives. Je n’ai pas besoin de vous dire que nous avions des appréhensions. D’abord, y avait-il des archives, et où ? Étaient-elles en bon état ? Dans quelle mesure étaient-elles fiables ? Nous avons profité de l’expérience acquise dans d’autres pays. Nous n’avons pas répété les erreurs commises en Afrique du Sud, où des audiences avaient été organisées dès l’entrée en fonction de la Commission Vérité et Réconciliation, sans grande préparation et notamment sans examen préalable des profils des victimes, de leurs déclarations et témoignages. Le travail initial a été réparti entre deux équipes d’enquête. La première est partie à la recherche des archives en frappant à la porte de la gendarmerie, de la police, de l’armée… La deuxième est allée directement vers les victimes. Cette méthode, pragmatique, s’est révélée bonne, et si d’autres commissions, où que ce soit, ont un jour à procéder à ce genre d’enquête, elles feront bien de s’en inspirer. Donc, les deux équipes ont travaillé sur le terrain pour retracer les événements et recouper leurs découvertes. Aux archives, la recherche a été très difficile. Les archives sont plus ou moins bien organisées, mais au moins, elles existent. Car il y a, dans les administrations, un culte des archives. Beaucoup d’observateurs se sont inquiétés, au cours des six premiers mois de fonctionnement de l’IER, de ne rien voir sortir. Mais ce travail préparatoire était indispensable et devait être discret. Une grande surprise, à ce niveau, a porté sur ce qu’on appelle les « exécutions extrajudiciaires ». Beaucoup d’associations étaient persua¬dées que les assassinats clandestins avaient été nombreux et méthodiques. Or il y en a eu beaucoup moins qu’on pouvait le penser et, surtout, cela ne relevait pas d’une technique systématique utilisée par le régime. Ne peut-on pas tuer sans laisser de traces ? Il y a eu des assassinats dans des situations et des cas particuliers. Les éléments que nous avons recueillis montrent cependant que la pratique n’était ni systématique ni massive, et que c’est l’arrestation et la détention arbitraires, souvent accompagnées de la pratique de la torture, qui ont constitué la principale technique répressive utilisée pour contrôler ou domestiquer les factions radicalisées ou réfractaires de la classe politique tout en les maintenant à l’intérieur du système. Cette politique était en phase avec un système de gouvernance autoritaire mais soucieux de ne jamais couper les ponts, y compris avec ses adversaires les plus farouches… De façon générale, je tiens à rappeler que nous avons établi une série de critères d’élucidation et de procédures de clôture. Ces critères nous permettaient de déclarer un cas clarifié lorsque le sort et le lieu où se trouve la personne, en vie ou décédée, sont établis, élucidés, sous réserve bien évidemment de l’acceptation des familles concernées. Il y a eu beaucoup de disparitions… Pas des dizaines de milliers comme au Pérou, en Irak ou en Birmanie. Et dans ces pays, la disparition était définitive. Au Maroc, les disparus pouvaient revenir, ce qui n’était pas sans absurdité, comme l’a relevé Amnesty International. Mais nous n’avons pas la prétention d’expliquer. Nous livrons les faits et nous les analysons sommairement. C’est ainsi que nous avons pu établir des catégories de victimes, par âge, par sensibilité et par région, ce qui a permis d’organiser les auditions. Comment ont été organisées les auditions publiques ? Les audiences publiques ont été des moments forts de vérité, de restitution des mémoires douloureuses ; elles ont mis en scène des actes d’émancipation permettant aux anciennes victimes d’effacer symboliquement les traces de leurs traumatismes, mais aussi de s’adresser directement à l’ensemble de la société, à partir d’un espace public de parole et de délibération citoyenne, avec la participation de l’État, qui, de ce fait, reconnaissait en ces victimes des personnes et des citoyens. L’expérience était inédite et n’était pas sans risques. Les premières audiences publiques ont eu lieu à Rabat les 21 et 22 décembre 2004 et ont été radiotélévisées. Au cours de cette séquence inaugurale, nous avons tenu à ce que figurent toutes les générations et tous les moments historiques, ainsi que différentes sensibilités. Ensuite, nous sommes allés dans les régions : Rif, Moyen-Atlas, Rachidia, Marrakech… Ces auditions étaient une sorte de catharsis permettant aux victimes de s’exprimer directement. Mais, pour nous, la priorité était ailleurs : faire entendre les victimes, montrer aux citoyens ordinaires ce qu’étaient les victimes, laisser ?celles-ci s’exprimer. Comment ont réagi les Marocains aux auditions publiques ? Tout le monde a suivi les retransmissions à la télévision, et plus encore à la radio, qui est beaucoup plus proche des gens. La presse écrite, publique et privée, a organisé des débats. Dans les villages, après chaque audience, on se réunissait, on redécouvrait les personnes qui venaient de témoigner, on décortiquait les contextes… Des auditions thématiques, retransmises elles aussi à la télévision, ont prolongé les débats sur la transition démocratique, la violence politique, l’éducation et la culture des droits de l’homme, les réformes économiques… Ce qui a d’abord frappé l’opinion, ce qui a été la plus grande surprise est que les victimes n’étaient pas toutes des intellectuels, que cela pouvait être n’importe qui, une paysanne… Je pense au témoignage de cette femme qui a raconté que sa sœur, petite bergère, fut accusée d’avoir apporté des provisions aux hommes de Fqih Basri en 1973. Elle fut arrêtée, torturée, violée. D’anciens collaborateurs de Hassan II ont objecté que ce grand déballage allait être dangereux pas seulement pour le régime, mais aussi pour le pays. Ils posaient cette question : à quoi cela pouvait-il servir ? À vrai dire, tout le monde appréhendait des risques de toutes sortes, de dérapage, d’instrumentalisation ou de provocation. L’analyse des articles de la presse marocaine et internationale permet de retracer les divers positionnements. Il y a d’abord ceux, de tous bords, qui ont cru sincèrement que c’était une aventure périlleuse aussi bien pour l’État que pour la société, ainsi que pour l’IER elle-même, qui risquait, si les auditions venaient à échouer, d’être discréditée. Ensuite, ceux qui n’y voyaient qu’une manière d’enterrer la vérité à bon compte, la plupart invoquant des conceptions idéologiques ou sélectives des droits de l’homme. Et enfin, troisième catégorie, les conservateurs : ce sont d’anciens commis de l’État, des hommes politiques et des agents des services à la retraite. Certains d’entre eux ont proféré à notre égard des insultes et ont été jusqu’à nous accuser de comploter contre la monarchie… Ce que les extrémistes des deux derniers camps n’ont pas compris, les uns par mépris pour la « populace », les autres par méconnaissance des attentes des « masses populaires » dont ils disent exprimer les aspirations, c’est que la société marocaine ne peut vivre en permanence dans le refoulement et le ressentiment, et que les auditions publiques, les auditions thématiques et tous les espaces de débat ouverts répondaient à un fort besoin de dialogue dans le pays. Que répondez-vous à ceux qui disent que l’IER ne servait à rien, puisqu’elle n’aboutissait pas au jugement, au châtiment des coupables ? Au-delà des violations imputables aux individus, qui sont et qui restent du ressort de la justice, au-delà du fait que les responsabilités individuelles et l’identité des responsables présumés n’étaient pas au centre du travail public de l’IER, c’est tout le système de gouvernance qui était en cause, et ce sont les institutions de l’État qui se sont trouvées chargées de tous les abus, y compris des forfaits perpétrés par ceux qui, parmi les anciens responsables, auraient été tentés de se retourner contre l’État. Revenons aux violations… Les abus recensés entre l’indépendance et la disparition de Hassan II, soit de 1956 à 1999, décrits par les victimes dans les quelque 22 000 dossiers instruits par l’Instance se rapportent à la « disparition forcée », à la détention arbitraire, à la torture, à différentes formes d’atteinte au droit à la vie, à des abus spécifiques contre les femmes, à l’usage disproportionné de la force publique, aux immixtions arbitraires dans la vie privée, à l’exil forcé et aux conditions inhumaines de détention. Analysées et replacées dans leur contexte, ces violations sont des actes généralisés ou ponctuels constitutifs des pratiques répressives qui ont marqué des cycles de tensions, de luttes de pouvoir, de rébellions ou d’explosions sociales connus de l’histoire politique du pays, de 1956 à 1959, 1963 à 1965, 1972 à 1976, 1981 à 1985 et en 1990. Leurs causes structurelles ont trait, en dernière analyse, au système politique et de gouvernance, aux choix de société et de développement économique et social, et au système de valeurs et de culture politique. Parlons maintenant de votre itinéraire. D’où venez-vous ? De la région des Zemmour, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Rabat, plus précisément de la tribu des Aït Ouahi, où je suis né en 1950. Je suis berbère, d’une famille modeste. Enfant, jusqu’à 12 ans, j’ai subi deux influences politiques contradictoires de deux proches parents. Le premier est Bel Miloudi, l’un des chefs de l’Armée de libération : hostile à la domination de l’Istiqlal, il avait mené la rébellion d’Oulmès en 1958. Le second est Si Ameur Benbouzekri, figure de l’Istiqlal, signataire du Manifeste de l’indépendance du 11 janvier 1944. Il est candidat lors des premières élections législatives, en 1962, et me fait participer à sa campagne alors que je n’ai que 12 ans. Ancien de la fameuse école d’Azrou, instituteur puis directeur de collège, plus tard directeur de cabinet de Kacem Zhiri, ministre de l’Éducation nationale, Si Ameur était, jusqu’à sa mort en 1974, peu avant mon arrestation, mon guide et maître à penser. Il m’a initié à la culture berbère, au patriotisme et au combat politique. À 18 ans, je serai maoïste, il en sourira, mais respectera mon choix et me prodiguera des conseils dans les moments difficiles. En 1965, je quitte mon village pour aller à Tiflet et Khémisset. Quand éclatent les émeutes de mars à Casablanca, j’écris des slogans sur les murs avec d’autres jeunes. Entre 1965 et 1968, je dévore Voltaire, Rousseau et Diderot avant de rencontrer le marxisme et le romantisme révolutionnaire en vogue. Enfin, au lycée Hassan-II (ex-Gouraud, à Rabat), je subis certainement l’influence de profs de gauche, tant français que marocains. N’oubliez pas que je viens de la campagne et que j’étais fasciné par les idées qui étaient dans l’air du temps. C’était Mai 68 en France, le Vietnam, le maoïsme… Je découvre Souffles, une revue politique et littéraire publiée de 1966 à 1971, je rencontre ses animateurs, Abdellatif Laâbi et Abraham Serfaty, je suis séduit par les travaux - et l’action - de Paul Pascon, par Hassan Ben Addi, Noureddine Sail ou Abdelkebir Khatibi. J’adhère d’abord à un groupe de lycéens et d’étudiants du PPS (Parti du progrès et du socialisme, ex-Parti communiste). Aziz Belal, Thami Khiyari et d’autres nous expliquent les choix du parti. Nous nous en lassons assez vite. Les perspectives que nous offrait le PPS ne nous paraissaient pas assez audacieuses… Le maoïsme correspondait mieux à notre état d’esprit. Lorsque Ilal Amam est créé (août 1970), à partir d’une scission du PPS, je me trouve naturellement au sein des premiers noyaux qui allaient semer la bonne parole parmi les masses populaires afin de les préparer à la révolution prolétarienne, façon Mao. Nous devions, à défaut d’une classe ouvrière d’avant-garde, mobiliser la paysannerie et les « intellectuels » - lesquels étaient, en fait, de jeunes lycéens et des étudiants… C’est Abraham Serfaty qui a mené la scission du PPS… Sans doute. Mais je ne connais pas tous les aspects de la petite histoire à ce sujet. J’étais chargé de constituer les premières cellules dans les Zemmour, le Moyen-Atlas et le Gharb. Il s’agissait d’une organisation clandestine ? Oui, dans la mesure où nous n’avons ni déposé de demande officielle ni cherché à obtenir une quelconque autorisation pour la constitution d’un parti politique ; le choix du cadre légal et institutionnel pour l’action politique relevait alors de l’impensé et de l’impensable. Mais nous diffusions des communiqués ou des tracts, nous nous positionnions en tant que « force » émergente et concurrente dans des secteurs traditionnellement contrôlés par les partis de gauche et nous allions leur « damer le pion » en contrôlant pendant deux ans l’Unem (Union nationale des étudiants du Maroc). En quoi consistait exactement votre travail ? Entre l’été 1970 et le printemps 1972, toute notre action était dirigée vers la société civile : investir les universités et les syndicats, les centres culturels, les médias. En ce qui me concerne, j’ai travaillé d’abord dans une association pour les droits de l’enfant avec, bien sûr, pour objectif de repérer et de recruter des militants pour l’organisation. Je me suis intéressé ensuite aux syndicats d’étudiants et d’enseignants, avant de passer à la clandestinité pour échapper aux poursuites policières. Après la deuxième tentative de coup d’État (août 1972) et la malheu¬reuse guérilla déclenchée le 3 mars par Fqih Mohamed Basri, la stratégie du tout-répressif allait nous condamner à l’isolement. En réaction, nous adoptons une stratégie de repli de tous les espaces sociaux et culturels où nous commencions à peine à prendre racine ou, pour le moins, à nous faire connaître et parfois apprécier. Notre politique sera désormais plus agressive, et le système organisationnel devra épouser le modèle léniniste-stalinien. Nous rompons toutes relations ouvertes avec la société civile. Nous créons une structure clandestine, constituée de « révolutionnaires professionnels », pour construire un véritable parti révolutionnaire marxiste-léniniste « sous le feu de l’ennemi ». Nous déclarons la guerre idéologique au régime, aux partis politiques, aux mouvances marxistes ou populistes à tendance « putschiste » ou « blanquiste ». On assiste donc à une escalade dans la rhétorique révolutionnaire. Désormais, j’étais membre de la direction, chargé d’organiser la paysannerie dans plusieurs régions. En fait, nous ne pouvions toucher que les collégiens issus des campagnes, et c’était comme si nous contrôlions, par procuration, les paysans. C’est plus tard, en prison, que nous avons développé les premières réflexions critiques sur tous ces choix… S’agissait-il de perspectives, ou y avait-il un début d’action révolutionnaire ? Sur la violence, nos choix étaient purement théoriques. Nous étions foncièrement contre le putschisme et le blanquisme. À ma connaissance, aucune stratégie ni action de violence organisée n’a été engagée. On souhaitait, on projetait de susciter des actions de violence émanant des masses populaires pour nous affirmer comme un parti révolutionnaire seul capable d’encadrer « la violence populaire » avec les objectifs de « la révolution prolétarienne ». Concrètement, organisiez-vous des cellules ? Oui. Composées surtout de jeunes et de quelques intellectuels. Mais nous n’étions pas nombreux. La qualité du discours radical importait plus à nos yeux que le nombre de militants. Combien ? Quelques dizaines de cadres professionnels et peut-être quelques centaines de sympathisants organisés en de tout petits groupes, par ville ou secteur d’activité. En quoi étiez-vous dangereux du point de vue politique ou policier ? Je ne sais pas si nous l’étions réellement, mais nous perturbions peut-être les stratégies du pouvoir sur le plan médiatique et politique. Nous avions une certaine influence sur la jeunesse qui ressentait le besoin de changer les choses et à laquelle nous fournissions des slogans mobilisateurs, mais pas toujours cohérents. Nous appelions à changer le régime au nom de la démocratie, alors que nous-mêmes nous étions foncièrement opposés à la démocratie, sauf si elle préparait l’avènement de la dictature du prolétariat. Y avait-il une organisation militaire ? Absolument pas. On aurait pu penser que, sous l’influence maoïste, nous aurions organisé militairement la paysannerie. Certains de mes tortionnaires m’ont interrogé là-dessus et ont cherché à me le faire dire. Notre discours était, certes, émaillé d’appellations mystérieuses du type « bases rouges mobiles », « foyer révolutionnaire », mais nous n’avions ni les moyens ni la capacité de les créer et de les organiser. Du côté des services de sécurité, on cherchait à savoir si nous avions des relations particulières avec des groupes putschistes ou avec les maquisards proches de Fqih Basri. La police et le régime vous ont-ils surestimés ou avaient-ils besoin de vous faire passer pour plus forts que vous étiez ? Peut-être les deux à la fois. On peut dire qu’il y avait de la paranoïa amplifiée par la police pour gagner l’adhésion de la société et de la classe politique, et en particulier de l’UNFP et de l’Istiqlal, qui nous tenaient rigueur de notre dérapage au sujet du Sahara. Il était important, après les deux tentatives de coup d’État, de stabiliser et de pacifier le front intérieur, sur le plan médiatique en particulier. Car les rares actions d’éclat que nous suscitions parmi la jeunesse nourrissaient les campagnes intéressées des médias franquistes et algériens, et trouvaient écho auprès des mouvements d’extrême gauche en Europe. Quand la répression s’est-elle produite ? La première vague de dissuasion a commencé dès 1972, mais elle fut relativement moins féroce que la deuxième vague de démantèlement de 1974-1976. Après l’arrestation, à l’automne 1974, des principaux respon¬sables du 23-Mars, le groupe marxiste le plus important issu d’une scission de l’UNFP, la police tombe sur toute la documentation concernant en particulier le projet de réunification des différents groupes de l’extrême gauche : Ilal Amam, le 23-Mars, etc. C’est la rafle : tous les dirigeants sont arrêtés. Des camarades et amis aussi, dont Abdeltif Zéroual, qui est torturé à mort. L’amorce d’unification entre deux des trois petits groupes marxistes, Ilal Amam, 23-Mars et Linakhdoum Chaab, est tuée dans l’œuf. Nous cherchions aussi à internationaliser nos actions, et nous avions noué des contacts avec les groupes marxistes de Palestine, ainsi qu’avec ce qui nous semblait constituer un courant marxiste au sein du Polisario. Mais, à la vérité, nous n’avions aucune prise sur les réalités et nous étions déconnectés de l’évolution politique et géostratégique dans le sud de la Méditerranée et au Maghreb en particulier, par rapport aux stratégies des gouvernements algérien et espagnol. Qu’en est-il alors de votre position sur le Sahara ? À l’université, nous étions en contact avec les étudiants originaires des provinces du Sud, dont beaucoup seront parmi les fondateurs du Polisario, comme Mustapha el-Ouali Sayyed, qui voulaient, comme les anciens responsables de l’Armée de libération et les partis nationalistes, organiser la lutte contre la présence espagnole et accélérer la décolonisation de la région et se sentaient délaissés par tout le monde. L’idée à laquelle je me suis moi-même rangé était de soutenir tactique¬ment la revendication d’autodétermination tout en l’insérant dans une vision stratégique plus large de la « révolution arabe » comme cadre d’unification des mouvements révolutionnaires et des peuples de la région. Voilà ce que je retiens de l’idée de départ, mais je n’ai pas souvenir d’avoir jamais participé à de véritables débats sur cette question cruciale du Sahara et du principe de l’autodétermination. Tout au plus y avait-il un début de réflexion que la répression et le quasi-démantèlement des organisations marxistes léninistes en 1974-1976 ont pour longtemps figé… Et ce au moment où des mutations géopolitiques et stratégiques dans la région nord de la Méditerranée mettaient au jour de nouvelles dimensions de la question saharienne. Mais que s’est-il passé au tribunal ? L’opinion a surtout retenu que vous vous rangiez derrière le Polisario… Le procès a débuté en janvier 1977. Nous avions arrêté, Abraham Serfaty et moi-même en tant que membres de la direction de Ilal Amam, notre ligne de défense en concertation avec les responsables des autres groupes. Outre le procès du régime, nous avions décidé que seuls les membres de la direction pouvaient s’exprimer sur la question de l’autodétermination si l’on nous interrogeait sur le sujet. Mais plusieurs militants ont été piégés par le juge et certains ont proclamé leur soutien à la « République sahraouie ». C’était une surprise pour moi. Nous n’avions jamais défini, à ma connaissance, de position officielle sur cette question. De plus, nous n’étions pas les seuls concernés au procès. Les militants du 23-Mars, notamment, avaient une position diamétralement opposée à la nôtre et se sentaient doublement interpellés à la fois par l’amalgame entretenu par la cour au sujet de leur position et par les sorties de certains de nos dirigeants qui leur faisaient subir les conséquences du raidissement du tribunal sans leur donner la possibilité d’exprimer leur position. Vous aviez été torturés ? Oui, comme la plupart des détenus. La police savait beaucoup de choses sur les structures et l’idéologie et, pour ma part, j’étais questionné, à mon grand étonnement, sur de prétendus contacts avec les groupes armés proches de Fqih Basri ou avec le Polisario et sur les aspects opérationnels et logistiques de notre stratégie de la « violence de masse » dans les campagnes. Vous diriez que la torture était, pour la police marocaine, une manière d’enquêter ? C’est exactement cela. Où étiez-vous détenus ? À Casablanca de fin 1974 à janvier 1976, au centre de détention de Derb Moulay Chérif, puis dans la prison Aîn Ghbila pendant l’instruction et le procès. Après le verdict, nous avons été transférés, en mars 1977, à la prison centrale de Kenitra. Quel régime vous était appliqué à Kenitra ? Nous avons d’abord été tenus isolés, dans un quartier de haute sécurité, puis réunis en novembre 1977. Nous avons alors décidé une grève de la faim, une première au Maroc par sa dimension politique, qui a duré quarante-huit jours. Après la troisième semaine de grève, les deux tiers des prisonniers avaient été transférés à l’hôpital, ce qui facilitait les liaisons avec l’extérieur. Un comité était chargé des négociations avec l’adminis¬tration pénitentiaire, le ministère de la Justice et des parlementaires intervenus en médiateurs ; j’en ai assuré la coordination avec d’autres codétenus et amis dont feu Rahal Jbiha, Serifi, Fakihani, Hissane. Après de nombreuses péripéties, nous avons obtenu des conditions plus décentes de « vie », de communication avec nos familles et avec l’extérieur, l’organisation d’une bibliothèque, la réception de journaux, la possibilité de poursuivre des études universitaires. Nous nous sommes donné, avec le temps, un cadre de vie supportable. Nous avions des comités qui se chargeaient de répartir ce qui était apporté chaque semaine par les familles, d’organiser des débats politiques, des activités culturelles. Nous avons aménagé les espaces de promenade pour faire du sport ou pour planter des arbres… Entre-temps, j’ai démissionné de la direction et rompu totalement avec Ilal Amam en 1981. Le 16 août 1991, après seize ans, sept mois et seize jours, il y a presque quinze ans, je quittai à jamais la prison. Et j’en suis presque guéri. Propos recueillis par Hamid Berrada et PhillippebGaillard, parus dans Jeune Afrique du 22 janvier 2006